Une Histoire de la danse en images
Programme de huit courts métrages – 1h05
Composé de courts métrages des collections audiovisuelles du CND – Centre national de la danse, ce programme propose une traversée de la danse du début du XXe siècle jusqu’aux années 90. Chaque document montre un courant esthétique et une écriture chorégraphique propre à un ou une artiste qui a marqué l’histoire de la danse moderne et contemporaine.
Le Lys, extrait de La Féérie des ballets fantastiques de Loïe Fuller, 1934, 3 minutes, réalisé par George R. Busby, neuf chorégraphies de Loïe Fuller interprétées par la Compagnie des danseuses de Loie Fuller dirigée par Gab Sorère.
- En savoir +
-
Le Lys constitue l’épure majestueuse des films interprétés par les imitatrices de Loïe Fuller. Il est ici danse par Miss Baker, qui n’est pas une imitatrice mais une élève de Loïe Fuller, danseuse de sa compagnie des Ballets fantastiques, et ne s’attache pas à la métamorphose des couleurs, mais aux formes plastiques crées par la danse, dans leur nudité.
Ici, c’est le sublime de virtuosité qu’enregistre le long travelling de George R. Busby, qui moule la danse dans le temps de ses transformations, et laisse advenir les formes naturalistes qui naissent de la manipulation du voile. La fidélité chorégraphique de Miss Baker nous laisse entrevoir les palpitations qui rendaient les performances de Loïe Fuller aussi sidérantes.
« Danser… c’est vivre ! », extraits « Aspiration » et « Jeu de balle », chorégraphies d’Isadora Duncan, transmission de Lisa Duncan, 5 minutes, réalisation de Jacques Pyros, interprétation d’Odile Pyros et Valérie Pyros, 1971.
- En savoir +
-
Le film de Jacques Pyros (le mari d'Odile Pyros), tourné dans un très bel extérieur à Châteauvallon sur le répertoire chorégraphique d’Isadora Duncan et de Lisa Duncan, est interprété par Odile Pyros et sa fille Valérie. Lisa Duncan était l’une des Isadorables, le nom donné aux élèves de l’école de danse fondée par Isadora Duncan. Lisa Duncan s’installa à Paris et ouvrit une école de danse dans laquelle Odile Pyros entra à l’âge de 11 ans. Elle devint par la suite danseuse et assistante auprès de Lisa Duncan. Elle participa, au cours de ces années, aux spectacles, récitals et tournées de la troupe de Lisa Duncan et sa famille devint intimement proche de Lisa Duncan. Isadora Duncan n’ayant jamais été filmée en train de danser, la transmission de ses chorégraphies s’est faite par les Isaborables. On peut donc estimer que l’interprétation d’Odile Pyros notamment s’approche le plus de celle d’Isadora Duncan.
« Air for the G. String », 1934, 7 minutes, NB, sonore, document sur Doris Humphrey, musique de Jean-Sébastien Bach, avec Cleo Athenof, Doris Humphrey, Dorothy Lathrop, Hyla Rubin, Ernestine H. Stodell.
- En savoir +
-
« Air for the G String » rassemble certaines caractéristiques de la danse de Doris Humphrey, faite de formes amples, rondes, d’un mouvement qui se caractérise par sa plénitude. En 1929, une de ses premières pièces comme chorégraphe, « Water Study », travaillait sur la recréation par un groupe de danseurs du mouvement des vagues, tout en rondeur et en ondes. « Air for the G String » est traversé par une volonté sculpturale de la figuration du groupe de danseuses (dont Doris Humphrey elle-même), dans laquelle on retrouve la question du drapé, si importante dans l’histoire de l’art… et dans l’histoire de la danse (Loïe Fuller).
« Lamentation », musique interprétée par Louis Horst, c. 1950, chorégraphie et interprétation de Martha Graham, 3 minutes.
- En savoir +
-
Ce solo « Lamentation » bouleversant a été créée à New York le 8 janvier 1930, au Maxine Elliot's Theater, sur une musique du compositeur hongrois Zoltán Kodály. La danse est exécutée presque entièrement en position assise, Martha Graham étant enveloppée dans un tube de jersey violet. Les diagonales et les tensions formées par son corps qui se débat dans le matériau créent une sculpture en mouvement, un portrait qui présente l'essence même du deuil. La figure de cette danse n'est ni humaine, ni animale, ni masculine, ni féminine : c'est le deuil lui-même.
Chrysalis, 1973, extrait 10 minutes, réalisation d’Ed Emshwiller, chorégraphie d’Alwin Nikolaïs.
- En savoir +
-
Alwin Nikolais établit une équivalence en qualités, entre les danseurs, les costumes, les sons et les lumières ; chaque élément du spectacle représente un médium singulier, ayant son registre de rythmes propres, qu’il s’agit d’agencer avec les autres en volume extensible. Avec Alwin Nikolais il y a un rythme-corps, un rythme-costume, un rythme-son, un rythme-lumière. Ce n’est pas par hasard si Alwin Nikolais a fait appel à l’un des cinéastes les plus novateurs, Ed Emshwiller, pour la réalisation de ses films de danse. Ils ont en commun l’attrait pour le mouvement des couleurs dans l’air. Pour eux la couleur, la lumière dans l’espace peuvent être aussi substantielles que sur une toile.
« Réalisé en collaboration avec Alwin Nikolais et sa compagnie de danse. CHRYSALIS est le résultat de la structuration d'une série d'idées cinématographiques et de danse que Nikolais et moi avons eues. Le film implique les danseurs dans des chorégraphies improvisées, des costumes variés et des techniques cinématographiques allant du ralenti à la pixilation (animation image par image). J'ai réalisé la bande sonore, en utilisant les voix des danseurs. » Ed Emshwiller.
Improvisation, danse de Pierre Droulers et film d’Eric Pauwels, 1985, 11 minutes.
- En savoir +
-
"Filmé en une seule prise et sans interruption, nous avons voulu que ce document soit le reflet d'un instant. Ni les mouvements de danse, ni ceux de la caméra n'ont été préparés : il s'agit d'une improvisation à tous les niveaux.17 novembre 1985. 19 heures" (Extrait du générique de début de film).
Melody Excerpt, 2013, 13 minutes, chorégraphie de Lucinda Childs, animation : Jorge Cousineau, à partir de la partition de Lucinda Childs, avec Megan Bridge, Nora Gibson, Janet Pilla, Michele Tantoco, Annie Wilson. Filmé en septembre 2013 au Fringe Arts de Philadelphie.
- En savoir +
-
Vidéo présentant en format split screen, à gauche une représentation de la pièce « Melody Excerpt » et à droite, la partition animée de cette pièce, dessinée par Lucinda Childs elle-même. Cette vidéo a été commandée par The Pew Center for Arts & Heritage pour faire partie de son programme en ligne A Steady Pulse: Restaging Lucinda Childs, 1963–78.
Emmy, 1995, 11 minutes, chorégraphie et réalisation de Daniel Larrieu, lumière de Reda Berbar, musique d’Henryk Mikołaj Górecki, costumes de Françoise Han Van pour Marithé et François Girbaud, interprétation de Daniel Larrieu et Matthieu Doze.
- En savoir +
-
Écrit pour la scène, et transposé pour le cinéma, un autoportrait d'un solo construit sur la musique, un rituel tourné dans une chapelle, avec Matthieu Doze. (site Daniel Larrieu)
Emmy, réalisé, chorégraphié et interprété par Daniel Larrieu. Sur le thème de l'autoportrait, ce film propose plusieurs aspects d'un même solo, dansé en direct, diffusé en vidéo et projeté en 16 mm. Différents points de vue captés par une caméra en mouvement. Un corps seul que traverse une musique de Gorecki. Rigoureuse sans être austère, sa danse privilégie le haut du corps : tête, nuque, mains ; tandis que les jambes le portent de carré en diagonale dans un costume blanc artisanal rapporté de Thaïlande. (site Film-Documentaire)
Autour de la programmation
-
Image
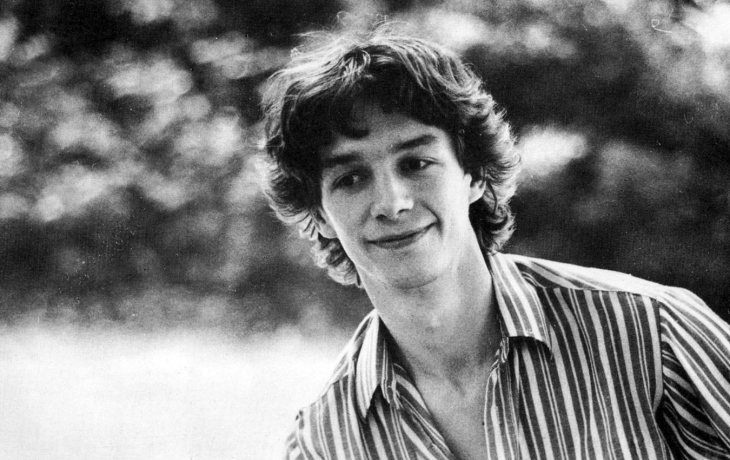 Le 10 maiMarie-Hélène Rebois – 54 min, France, 1999
Le 10 maiMarie-Hélène Rebois – 54 min, France, 1999 -
Image
 Le 10 maiDD Dorvillier
Le 10 maiDD Dorvillier -
Image
 Du 19 avril au 21 septembre« Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe-XXIe siècle) »
Du 19 avril au 21 septembre« Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe-XXIe siècle) »


